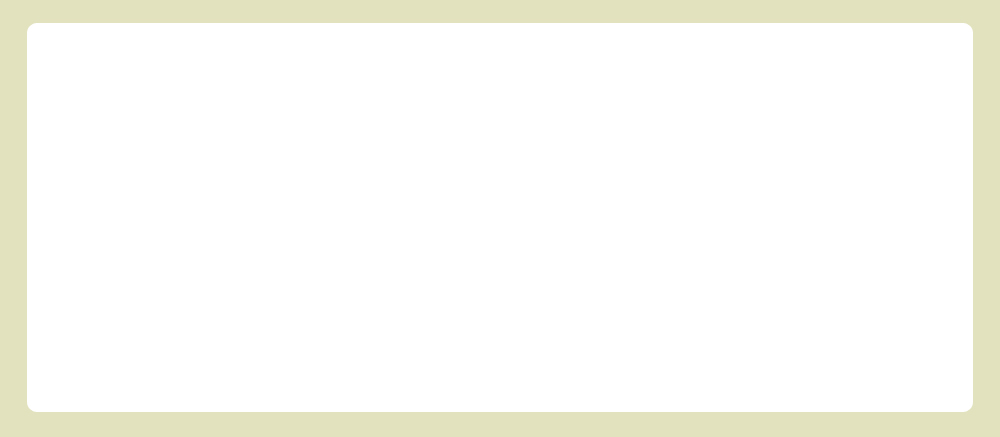Christ en croix (17e siècle)
Au siècle dernier, les experts pensaient que ce tableau était l’œuvre du maître flamand Antoon Van Dyck. Aujourd’hui il paraît plus raisonnable de dire « école Van Dyck ».
La représentation du Christ en croix a une histoire particulière.
Cette représentation a évolué via des peintures ou des crucifix, et a obéi, suivant les lieux et les époques, à différentes conventions :
Les premiers chrétiens ont évité de représenter le Christ en croix, image exceptionnellement rare même après que l’empereur Constantin ait institué le christianisme religion d’Etat au 4e siècle. L’apparition de ce thème est symptomatique du passage de l‘antiquité au Moyen-âge, et les premières représentations monumentales du Christ sur la croix datent de l’époque carolingienne (9e siècle).
Durant le Moyen-âge, c’est le « Christ triomphant » (Christus triumphans), qui est représenté. En tant que personnalité divine, il est impassible, ses yeux sont grands ouverts et parfois regardent vers le ciel.
Le « Christ mort » (Christus patiens, résigné), est représenté dans la peinture byzantine, dite « manière grecque ».
Les primitifs italiens de la pré-Renaissance ont initié la représentation du « Christ humanisé », donc souffrant le martyre (Christus dolens). A la période moderne, la scène est habituellement complétée de certains attributs : le mont Golgotha, la présence de Marie, Marie-madeleine, Jean, les larrons, les soldats…la douleur se lit sur le visage de Jésus, la musculature et la pesenteur du corps sont bien visibles dans toutes les représentations européennes, notamment chez l’école flamande.
Au 19e et 20e siècles, l’image du Christ en croix reste celle qui symbolise la tradition artistique occidentale, malgré la « déchristianisation » des périodes contemporaines. De nombreux artistes contemporains ont d’ailleurs repris ce thème (souvent avec des visées iconoclastes) : Picasso, Saura, Bacon…